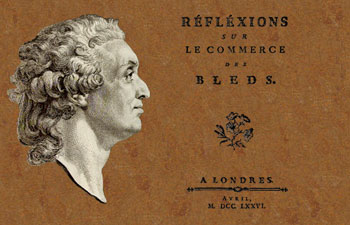
|
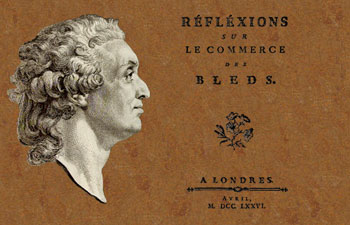 |
|
A L O N D R E S . A V R I L. M. DCC. LXXVI. |
| AVERTISSEMENT. |
Cet Ouvrage dont quelques circonstances ont retardé la publication, est imprimé il y a long-temps 1; en le relisant j’ai trouvé quelques passages qui m’ont paru demander des éclaircissemens. |
I. J’ai donné page 25, la diminution de la consommation du Pauvre dans les chertés excessives, comme une raison de ne pas craindre les manœuvres des Marchands ou des Boulangers, parce que cette diminution expose les Marchands à garder leur bled, donne à la concurrence le temps de se rétablir & qu’ainsi, cette moindre consommation suffit pour ôter toute possibilité de produire une famine en quelques jours, Mais je n’ai eu garde de |
a |
| ij |
| prétendre que la diminution forceé de la consommation ne fut pas un très-grand mal, j’ai voulu dire seulement que les Marchands de bled ou de pain, n’ont aucune possibilité de causer la famine, ni aucun intérêt de faire monter les subsistances fort au-delà de leur prix naturel, & par conséquent d’obliger le peuple à diminuer sa consommation. |
J’ajouterai ici que cette diminution dans la quantité des subsistances, ou le changement de nourriture auquel on est quelquefois obligé d’avoir recours, ne peut produire un effet sensible, que lorsqu’il y a d’une année à l’autre une disproportion très-grande entre les prix; que l’égalisation des prix est le reméde le plus sûr de ce mal |
| iij |
| dont les effets ne sont pas à craindre à moins qu’il ne dure longtemps, & que la diminution n’ait un rapport assez grand avec la quantité totale de la consommation. Alors il est d’autant plus terrible qu’il détruit presque sans ressource le temperamment des jeunes gens & des enfans, s’oppose à leur croissance, dérange même leur conformation ; & voila encore une cause de dépopulation & de dégradation de l’espéce humaine dont la liberté du commerce des subsistances sera le reméde. |
Qu’on ne me reproche donc point d’avoir regardé comme une chose peu importante un mal dont les funestes effets m’ont souvent fait gémir, qu’on ne m’accuse point d’avoir manqué de respect pour la misere du |
A ij |
| iv |
| peuple. J’ai cherché au contraire à le rassurer contre des craintes que l’excès de la misère rend sans doute excusables, & à faire sentir, qu’heureusement pour lui, les effets du mal qu’on voudrait lui faire, en cherchant à l’affamer, seraient trop lents pour que des méchans pussent profiter de son malheur & espérer de s’enrichir en l’y plongeant. |
II. J’ai dit aussi page 32, qu’un Ouvrier qui exigerait un salaire supérieur à ce qui est nécessaire pour vivre, au plus grand nombre de Salariés, serait exposé à manquer d’ouvrage. En effet, comme ce n’est pas une vue d’humanité qui fait employer les Salariés mais une vue d’intérêt; il faut nécessairement que le taux général des salaires se régle sur ce qui est |
| v |
| nécessaire à la subsistance du plus grand nombre de familles. Celles qui auraient besoin que leurs chefs eussent des salaires plus forts, tombent dans la misère & n’en sont tirées que par des secours particuliers; les hommes ont assez d’humanité pour secourir les malheureux qui souffrent, mais ce serait trop espérer d’eux que de les croire capables en général de sacrifier leur intérêt habituel : de hausser par exemple, le prix des salaires uniquement pour rendre le peuple moins misérable, ou d’employer par préférence les Salariés qui ont besoin d’un salaire plus fort. |
Il est horrible sans doute que, dans la classe des Salariés qui n’ont pas de métier, un grand nombre d’enfans, une femme infirme, des parens âgés, |
a iij |
| vj |
| réduisent un chef de famille à une misère presque inévitable. Mais elle ne l’est réellement que quand des loix prohibitives, des impôts indirects, viennent mettre des entraves à l’industrie du peuple, troubler son repos l’exposer à des avanies & à des vexations ; ôtez ces entraves, vous verrez la culture se perfectionner & se varier, l’ame du peuple prendre plus d’activité & d’énergie : de nouvelles branches d’industrie se créer, le peuple enfin, multiplier ses ressources, devenir plus indépendant du riche, pouvoir en exiger des salaires assez forts, non seulement pour subsister, mais pour se mettre à l’abri des accidens. S’il peut y avoir quelque équilibre entre ceux qui ont tout & ceux qui n’ont rien ; c’est seule- |
| vij |
| ment entre le besoin qu’a le pauvre de l’argent du riche, & celui qu’a le riche de l’industrie du pauvre, que cet équilibre peut s’établir. |
III. J’ai cité souvent l’Ouvrage de M. N. mais sans avoir la témérité de prétendre lui répondre. J’ai voulu seulement en rapportant les objections des Prohibitifs, me mettre à l’abri de l’accusation d’avoir combattu contre des chimères. Il fallait donc citer. J’ai choisi l’Ouvrage de M. N. 1 comme le plus nouveau des Ouvrages prohibitifs, & celui auquel les circonstances où il a été rendu public (a) ont |
| (a) Il a paru entre les émeutes de Dijon & celles de Paris 2, & la deuxiéme édition a été distribuée au milieu de ces dernieres émeutes. Il était impossible de choisir une circonstance plus favorable au succès d’un |
| viij |
| donné plus de célébrité. D’ailleurs, quoiqu’il n’ait cité personne, certainement cet Auteur a trop de génie pour n’avoir pas inventé tout ce qu’on a pu imprimera vant lui d’un peu supportable. |
M. N. a donné des leçons de l’art de traiter les sciences politiques. Il ne veut pas qu’on emploie l’analyse pour en approfondir les grands principes, C’est, dit-il, un instrument de Réteur qui sépare, qui divise tout, il faut les envelopper de la pensée, ou renoncer à les concevoir. |
Or, j’avoue à ma honte, qu’en étudiant l’histoire des Sciences j’ai cru m’appercevoir que depuis Hypocrate & Pithagore jusqu’à Loke & M. Dalembert, |
| Livre d’éloquence où l’on attaquait les principes qui servaient de prétexte à l’émeute. |
| ix |
on n’avait fait aucune découverte que par l’analyse, j’avoue que je ne sçais pas du tout comment on enveloppe un principe de la pensée, & qu’ainsi il me serait impossible de m’entendre avec M. N. sur les principes de l’économie politique. |
Un autre motif plus général eut suffit peut-être pour me détourner d’écrire une critique particuliere. Le public accueille avec plaisir les satyres les plus violentes, quand elles attaquent un homme de lettres. Celui qui regarde la Littérature ou la Philosophie comme l’occupation de sa vie, semble annoncer la prétention d’écrire ou de penser mieux que les autres hommes. Le public voit donc toujours avec plaisir contester cette prétention. On ne se dit pas, si j’a- |
| x |
| vais écrit, je n’aurais pas eu tant d’esprit ; mais on se dit j’aurais évité d’être si ridicule, je n’aurais pas avancé de telles absurdités ; l’homme le plus médiocre trouve dans les critiques de quoi se préférer en secret, à l’homme le plus justement illustre, & n’y eut-il que la sagesse d’avoir évité de s’exposer en public, voila déja un dédommagement pour l’amour-propre. Combien de gens humiliés par la supériorité d’un grand homme, se sont-ils consolés en lisant les sarcasmes d’un Folliculaire ? C’est peut-être même un bien pour les hommes d’un véritable génie; qui sçait à quels excès se porterait l’envie, si le respect pour la personne d’un grand Ecrivain était égal à l’admiration qu’inspirent ses ouvrages ? |
| xj |
Qui sçait si souvent il n’a point dû à cette persécution littéraire l’avantage d’échapper à une persécution plus sérieuse. |
Avant l’invention de l’Imprimerie, les Ecrivains jaloux n’avoient d’autre ressource que de dénoncer leurs ennemis, & souvent ils parvenoient à les envoyer au supplice. Maintenant que la haine peut s’exhaler en libelles, elle a moins d’atrocité, & les Lecteurs qui voient outrager le grand homme, dont la gloire les fatigue, lui pardonnent & ne le brulent point. |
Mais ce public si indulgent pour les satyres contre les Auteurs , n’est plus le même si la critique s’exerce sur un homme du monde devenu Ecrivain par désœuvrement, par convenance, par politique. Comme la préten- |
| xij |
| tion de l’Auteur est alors de prouver aux Ecrivains de profession qu’il ne tient qu’aux gens du monde de penser ou de s’exprimer aussi bien qu’eux : les Lecteurs ne voient dans l’Auteur critiqué que le défenseur de leur cause, & la critique au lieu de consoler leur amour-propre, l’humilie. Ils regardoient d’ailleurs le désagrément d’être exposé à la censure, comme un inconvénient particulier de l’état des gens de lettres, inconvénient propre à compenser la réputation de supériorité de lumieres accordée à cette classe d’hommes : mais lorsque la critique ose discuter l’ouvrage d’nn homme du monde, les Lecteurs ne font plus aussi bon marché de l’amour-propre des hommes de leur état, que de celui d’un |
| xiij |
Auteur, & la critique la plus modérée paraît une satyre (a). |
Ce serait sans doute une bien mauvaise politique à un Littérateur de braver cette disposition générale. |
Qu’importe que le public se trompe pendant quinze jours sur 1e mérite d’un Ouvrage qu’il doit ensuite oublier pour jamais ? |
(a) Par exemple, un homme du monde fait des livres où il
compare une société d’hommes de lettres estimables à des bêtes féroces.
Il verse à grands flots le mépris le plus outrageant sur tous les Philosophes
qui osent traiter les questions de politique, bien que lui-même n’ait
aucun autre titre pour s’en occuper, il choisit pour ses premieres hostilités
contre eux, un temps où la liberté d’écrire leur est enlevée, & tout
le monde admire sa modération 1. |
| xiv |
Quel grand mal y aurait- il qu’un faiseur de phrases se crut un grand homme dans sa coterie (a)? |
Mais si ces querelles d’amour-propre avilissent la Littérature, le courage de s’élever au-dessus de toutes les petites |
(a) Un Auteur moderne a imprimé que la vanité est une vertu sociale, parce qu’elle met son bonheur entre les mains des autres; (Eloge de Colbert, page 34. 1 ) Mais comme la vanité se place toujours dans la jouissance des choses dont une grande partie des hommes est privée, il s’en suit que la vanité n’a besoin des autres que pour en faire ses victimes, & qu’ainsi elle est précisément un vice anti-social; nous conviendrons cependant qu’elle peut faire le bonheur de ceux qui en sont attaqués, mais seulement, lorsqu’elle est au point d’altérer la raison : alors elle est un bien tant que l’illusion dure, & il y a de la cruauté à la faire cesser. C’est pour cela qu’il est contre la Morale de dire du mal des méchans Auteurs, excepté lorsque leurs Ouvrages peuvent nuire, soit à des hommes honnêtes, soit à la chose publique. |
| xv |
considérations pour dire ce qu’on croît la vérité, ne peut que l’honorer. |
Puissent les gens de lettres craindre d’affliger la vanité de leurs confreres, lorsqu’il ne s’agit que de leur propre gloire , & ne pas craindre de se faire des ennemis, lorsqu’il est question de combattre pour la raison ou pour l’humanité. |
|
|
|
|